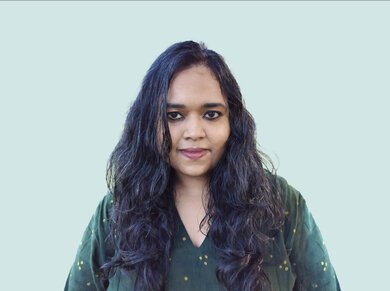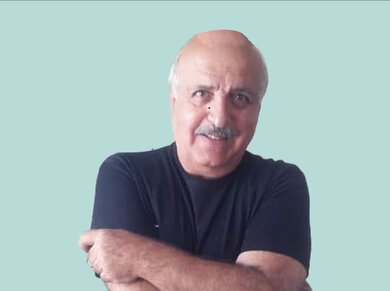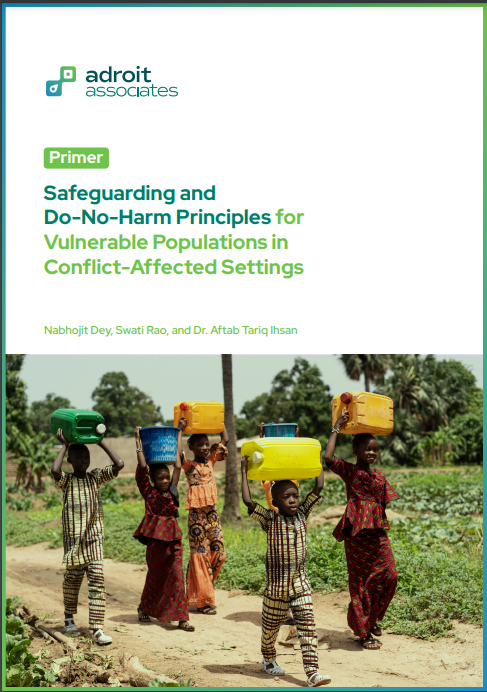L'objectif de ce guide est d'établir un cadre fondé sur le respect, l'équité, le consentement éclairé et la sensibilité culturelle. Il vise à aider les chercheurs, les institutions et les organisations à comprendre et à mettre en œuvre des pratiques qui non seulement respectent, mais donnent la priorité au bien-être et à la dignité des personnes vulnérables dans les situations de conflit. En adoptant ces principes, l'abécédaire cherche à favoriser un environnement dans lequel les interventions et les recherches impliquant des groupes vulnérables sont menées de manière responsable, transparente et avec un engagement inébranlable en faveur des normes éthiques.
La protection, une approche proactive axée sur la sécurité et le bien-être des individus, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables, fait partie intégrante de la recherche et des efforts humanitaires (Barron et al., 2022). Ce concept consiste à créer et à maintenir des environnements qui empêchent les préjudices, les abus ou la négligence, en veillant à ce que ces problèmes soient traités rapidement et efficacement. Dans les contextes de recherche, la sauvegarde implique une série de pratiques visant à protéger les participants vulnérables contre l'exploitation, les préjudices et d'autres conséquences négatives qui pourraient découler de leur participation aux activités de recherche.
Le principe "Do-No-Harm", une éthique fondamentale dans la recherche et le travail humanitaire, complète la protection en soulignant l'importance d'éviter tout préjudice involontaire lors de la fourniture d'une assistance dans le cadre d'un travail humanitaire ou d'un projet de développement, ou lors de la collecte d'informations (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2016). Ce principe est particulièrement crucial lorsqu'on travaille avec des populations vulnérables, qui sont souvent plus susceptibles de subir des préjudices et moins bien équipées pour en gérer les conséquences. Il nécessite une compréhension approfondie des impacts potentiels des interventions de recherche et un engagement à examiner attentivement et à atténuer tout effet négatif (Molesworth, 2022). Les principes de sauvegarde et de non-nuisance soulignent l'impératif éthique dans les pratiques de recherche et d'intervention humanitaire, en insistant sur la nécessité de protéger et de respecter les droits et la dignité de tous les participants, en particulier les plus vulnérables. Ces principes incitent les chercheurs et les praticiens à se concentrer non seulement sur les objectifs de leur travail, mais aussi sur les implications plus larges et les conséquences involontaires potentielles de leurs actions.